Dans quelque temps sortira mon second podcast. Youhou!
Le premier Inconsciente ! parle
- d'hypnose
- de développement personnel
- de transgénérationnel, sur plus de 96 épisodes.
Le second podcast sera lui, dédié à la généalogie antillaise.
Curieuse de voir ce qui existait déjà sur ce thème dans l'univers du podcast, j'ai cherché puis écouté avec une grande attention tout ce que Google me proposait, passant du récit historique de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion, au témoignage de descendants d'esclave et de colon.
Plusieurs d'entre eux sont réalisés par Radio France, France Inter,France Culture et Martinique la 1ère.
Voici ma petite sélection 2025 :
- Sur les traces de Désirée
- Les Antillais à la recherche de leur racine
- Les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage
- L'engagisme Africain en Guyane et aux Antilles françaises par Céline Flory Oliwon LaKaraïb
- Au nom de nos ancêtres, esclave et négociants
- Sur Les docks La Martinique et la Guadeloupe, d'hier à aujourd'hui (2/4) : "Martinique, une terre d'hommes cassés"
- Code noir, les révoltés du Gaoulet en 6 épisodes
Sur les traces de Désirée

Un voyage sonore intime et politique à la recherche de mon arrière-grand-mère martiniquaise (et mon arrière-grand-père guadeloupéen).
Navigant entre le passé et le présent, le singulier et le collectif, la poésie et la musique. Touchant des questions d'appartenance et d'afrodescendance en France et dans la Caraïbe, avec un ancrage féministe, antiraciste/décolonial et écologiste.
Je mets les pieds dans le plat de la question des traumas transgénérationnels, notamment coloniaux, de l'assimilation et de ce que l'on en fait, comment on les transforme, en allant à la rencontre de personnes qui travaillent ou vivent ces sujets.
Je vous embarque dans mon voyage et mes recherches par le biais de capsules sonores, extraites de mon "carnet de terrain" d'ethnologue au chômage qui fait son "auto-anthropologie".
Chercher ses racines, tout un travail...
Les Antillais à la recherche de leurs racines

Publié le 23 décembre 2015
Avec
Emmanuel Gordien Vice-président et responsable de l’atelier généalogie et d’histoire des familles antillaises de l’association CM98, Comité Marche du 23 mai 1998
Jean-Louis Beaucarnot Généalogiste
La généalogie est la science qui a pour objet la recherche de l'origine et la filiation des personnes et des familles et sa représentation.
L'engouement pour cette recherche est une véritable passion et pour 61% des Français c'est un vrai passe-temps considéré comme un phénomène de société. Les Antillais sont aussi à la recherche de leurs racines . Le 27 avril 1848, un décret du gouvernement de la IIe République abolit l'esclavage dans les colonies françaises. L'une des premières mesures prises à la suite de cette décision fut d'attribuer des patronymes aux anciens esclaves qui n'avaient jusqu'alors, pour identité, qu'un prénom et un matricule. Faire de la généalogie, c'est aussi honorer la mémoire des aïeux esclaves .
Quand les Français commencent-ils à porter des noms de familles et pourquoi ? Pourquoi cet engouement pour la généalogie ? Comment faire pour retrouver ses aïeux ? Qu'est ce que la généalogie dit de notre histoire ?
avec Emmanuel Gordien, vice-président et responsable de l’atelier généalogie et d’histoires des familles antillaises de l’association CM98 (Comité Marche du 23 mai 1998)
et Jean Louis Beaucarnot, généalogiste et auteur de "Dictionnaire étonnant des célébrités" Ed First -> beaucarnot-genealogie.com
Les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage

À propos de la série en 8 épisodes :
Le système criminel de la traite et de l'esclavage a permis à la France de devenir au XVIIe et XVIIIe siècles l'une des toutes premières puissances mondiales
Surtout, l'esclavage a déterminé une nouvelle hiérarchie socio-raciale et participé à la fondation de l'économie capitaliste. Une histoire mondiale, centrale, souffrant de nombreux poncifs, qui reste donc étrangement méconnue.
Ainsi, aujourd'hui, comment les enfants de la colonisation et de la traite ne considéreraient-ils pas comme une injustice le traitement que la France réserve à leur histoire - notre histoire commune ? A fortiori lorsqu'ils sont parmi les premières victimes de l'exclusion sociale...
Cette série enregistrée aux Antilles (Guadeloupe et Martinique) dévoile les travaux les plus récents et contre quelques idées reçues sur une histoire ô combien complexe.
Une série documentaire de Stéphane Bonnefoi, réalisée par Diphy Mariani.
La Martinique et la Guadeloupe, d'hier à aujourd'hui (2/4) : une terre d'hommes cassés

L'épisode intitulé "Martinique, une terre d’hommes cassés" est le deuxième volet de la série documentaire "La Martinique et la Guadeloupe, d’hier à aujourd’hui", diffusée le 22 mai 2012 dans l'émission "Sur les docks" sur France Culture.
Ce documentaire, réalisé par Fabienne Kanor, Véronique Kanor et François Teste, explore les séquelles de l'esclavage en Martinique et la quête de réparation menée par certains de ses habitants.
Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les anciens esclaves sont devenus libres, tandis que les anciens maîtres, les békés, ont été indemnisés pour la perte de leurs esclaves. Ce n'est qu'en 2001 que la France a reconnu la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité.
Le 22 mai, date de commémoration de l'abolition en Martinique, le documentaire donne la parole à des Martiniquais qui ont engagé des actions en justice contre l'État français, réclamant une reconnaissance et une évaluation des préjudices subis par leurs ancêtres. Cette démarche, soutenue par le Mouvement International de la Réparation (MIR) fondé par Garcin Malsa, vise avant tout à restaurer la dignité des descendants d'esclaves plutôt qu'à obtenir des compensations financières.
Parmi les intervenants, on retrouve Christophe Wosé Rangoly, un slameur qui ponctue le documentaire de sa chanson "Imajiné", l'avocat Alain Manville, l'historienne généalogiste Annick François-Haugrin, le maire de Sainte-Anne Garcin Malsa, ainsi que Paul Loumengo et Antoine Beuze avec sa famille. Leurs témoignages abordent des questions essentielles telles que la propriété foncière en Martinique, la mémoire de l'esclavage et la construction de l'identité martiniquaise.
Code noir, les révoltés du Gaoulet

Martinique 1710 : une île paradisiaque transformée un enfer pour Titus, Amadi, Jacob, Grison et les autres personnages au centre de cette fiction en 6 épisodes sur l'esclavage.
Code noir, les révoltés du Gaoulet : une fiction produite par d'Outre-mer 1ère qui n'épargne pas ceux qui l'écoutent. Dans le décor paradisiaque de la Martinique en 1710,
c'est en fait une descente aux enfers que ce podcast propose. En 6 épisodes, Code noir nous plonge dans la réalité brutale, sauvage, de ce que fut l’esclavage en s’inspirant
directement de faits réels : l’affaire du Gaoulet. Une révolte d’esclaves qui s’est achevée sur 17 condamnations à mort et 11 condamnations à la torture d’une cruauté
choquante.
Avec le récit de cette affaire, dont certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des auditeurs, Code noir nous fait entendre la réalité d’une société esclavagiste. La réalité du
pouvoir du fouet, du pouvoir de la terreur.
Les 6 épisodes du podcast se déroulent dans une ambiance de peur omni-présente dans cette société de la Martinique du 18è siècle qui est alors à un moment charnière, celui où les colons blancs craignent d’être trop surpassés numériquement par les esclaves et qui redoublent donc de violence comme l’explique l’historienne Myriam Cottias , conseillère éditoriale sur ce podcast et qui est interrogée dans trois épisodes bonus, compléments passionnants et indispensable de cette fiction.
Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants
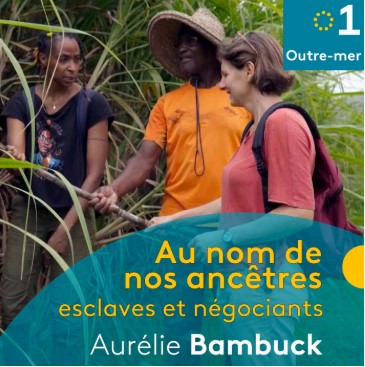
Aurélie Bambuck et Axelle Balguerie partagent la même histoire : leurs ancêtres ont participé à la traite négrière transatlantique. Mais l’une est descendante d'esclaves tandis que l’autre est descendante de négociants. En découvrant ensemble leurs arbres généalogiques respectifs, elles redonnent une âme à des statistiques et braquent le projecteur sur un passé sombre pour mieux éclairer l'avenir.
Présenté sous forme de dialogue entre deux représentantes d'une même histoire, ce documentaire inédit permet d'apporter un éclairage sur ces vies cachées et/ou oubliées qui participent à l'histoire de la France.
Aurélie Bambuck, fille de deux champions d'athlétisme originaires des Antilles, veut en savoir plus sur ses "branches taboues", celles mentionnant des ancêtres esclaves. En évoquant ses racines, ses parents ne sont jamais remontés jusqu’en Afrique. Ils lui parlaient des Indiens caraïbes, les premiers habitants de leurs îles, mais refaire la traversée de l’Atlantique dans l’autre sens était tabou. En interrogeant son père sur son premier voyage de sportif en Afrique, la jeune femme se rend compte "qu'être considéré comme descendant d’esclaves était une honte". Lorsqu'il participe aux Jeux de l'amitié en 1963 à Dakar au Sénégal, son père n’a pas eu conscience d’être sur la terre de ses ancêtres.
Axelle Balguerie partage le tabou et la honte vécue par ses parents alors que ses ancêtres n’étaient pas du côté des exploités, mais des exploitants : négociants, armateurs, négriers. Elle subit aujourd’hui cet héritage dans un monde qui demande des comptes. On lui reproche des crimes passés dont elle n’est pas responsable, on la pense riche héritière d’une fortune née de l’exploitation de l’homme par l’homme...
L'engagisme Africain en Guyane et aux Antilles françaises par Céline Flory et Oliwon LaKaraïb

Céline Flory est docteure en Histoire, Chargée de Recherche au CNRS, membre du laboratoire Mondes Américains et depuis 2012, membre du bureau du Centre International de Recherches sur les Esclavages et les post-esclavages (CIRESC).
Elle a été également membre du programme ANR ALTER « Histoires orales alternatives dans la Caraïbe (XIXe-XXIe siècles).
Ses recherches doctorales analysaient l’engagisme africain à la Guyane et aux Antilles françaises, c’est-à-dire le système mis en place par le gouvernement impérial du Second Empire après l’abolition de l’esclavage promulguée le 27 avril 1848 pour recruter, acheminer et mettre au travail des Africains munis de contrats d’engagement de travail de plusieurs années. Ses recherches visent maintenant à élaborer une histoire sociale des travailleurs africains, indiens et chinois, arrivés sous contrat d’engagement, et de leurs descendants afin de préciser les reconfigurations politiques, économiques, sociales, culturelles et raciales des sociétés françaises de la Caraïbe depuis la phase du post-esclavage jusqu’à la période contemporaine.
En conclusion
Un ensemble de podcast non exhaustifs à écouter ou réécouter, à confronter aux nouvelles informations qui font surface régulièrement, que ce soit via des conférences, des livres ou de nouveaux épisodes de podcast.
Si vous connaissez d'autres podcasts dans la même idée (histoire et généalogie) merci de les partager en commentaires.
Bonne écoute !
Pascaline

Je m'appelle Pascaline Nogrette
Créatrice d'Origine Créole
Aide et recherche en généalogie antillaise suite à 25 ans de recherches personnelles
1303 individus sur mon arbre Geneanet et 301 médias
Retrouvez-moi sur Instagram pascaline_genealogie
Et sur Facebook Origine Créole

Écrire commentaire